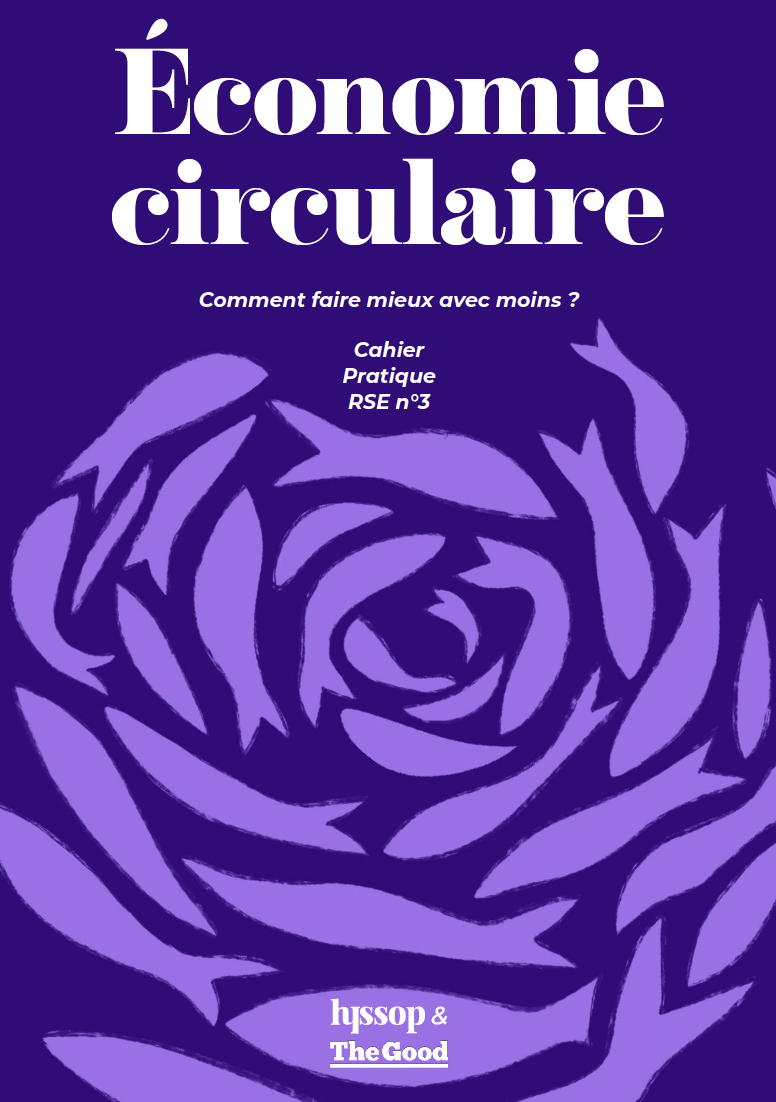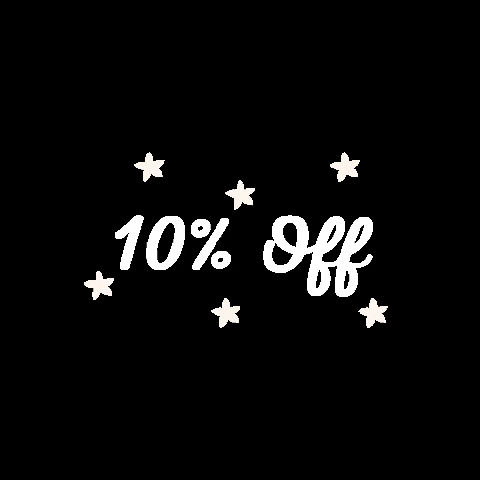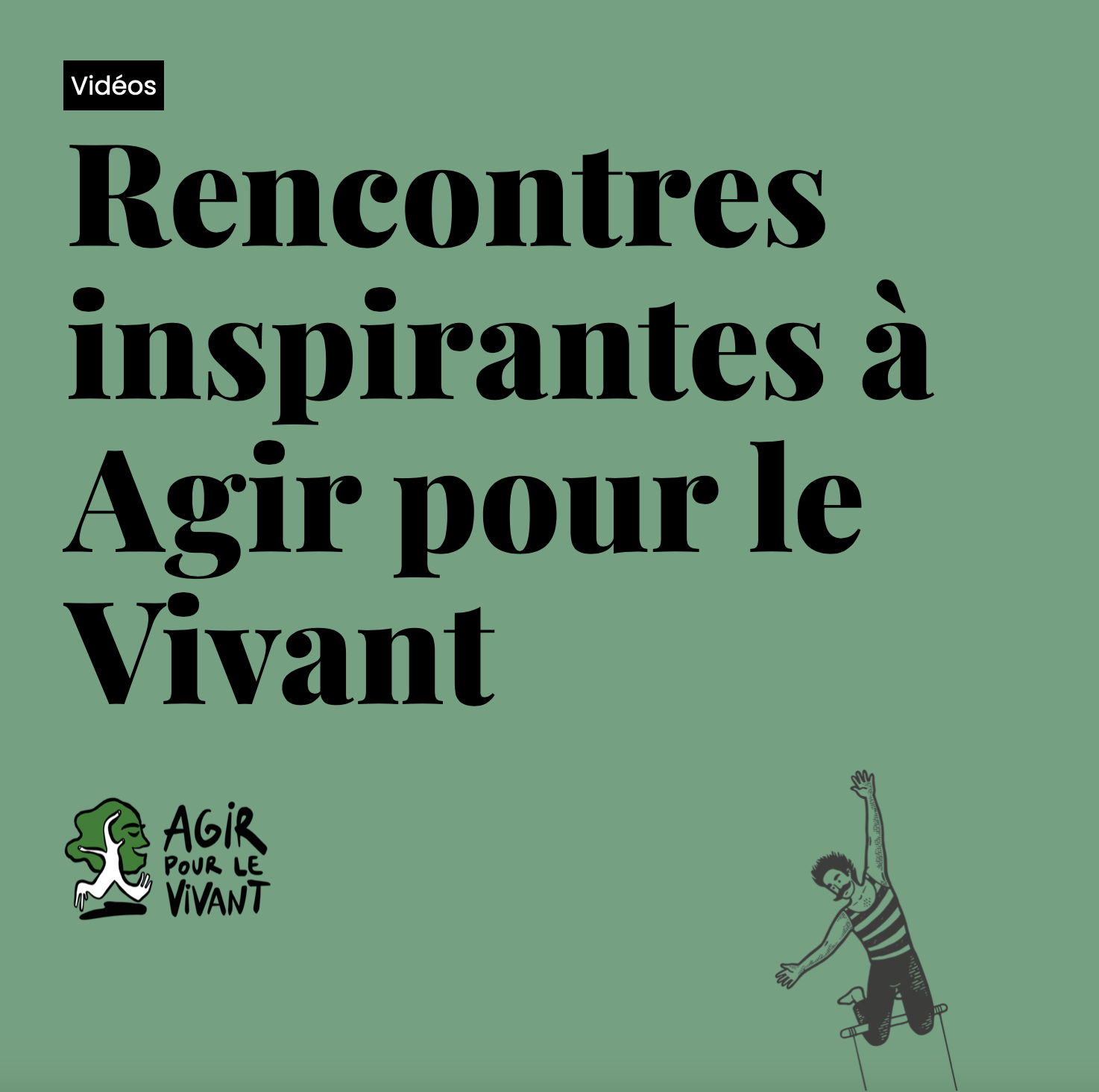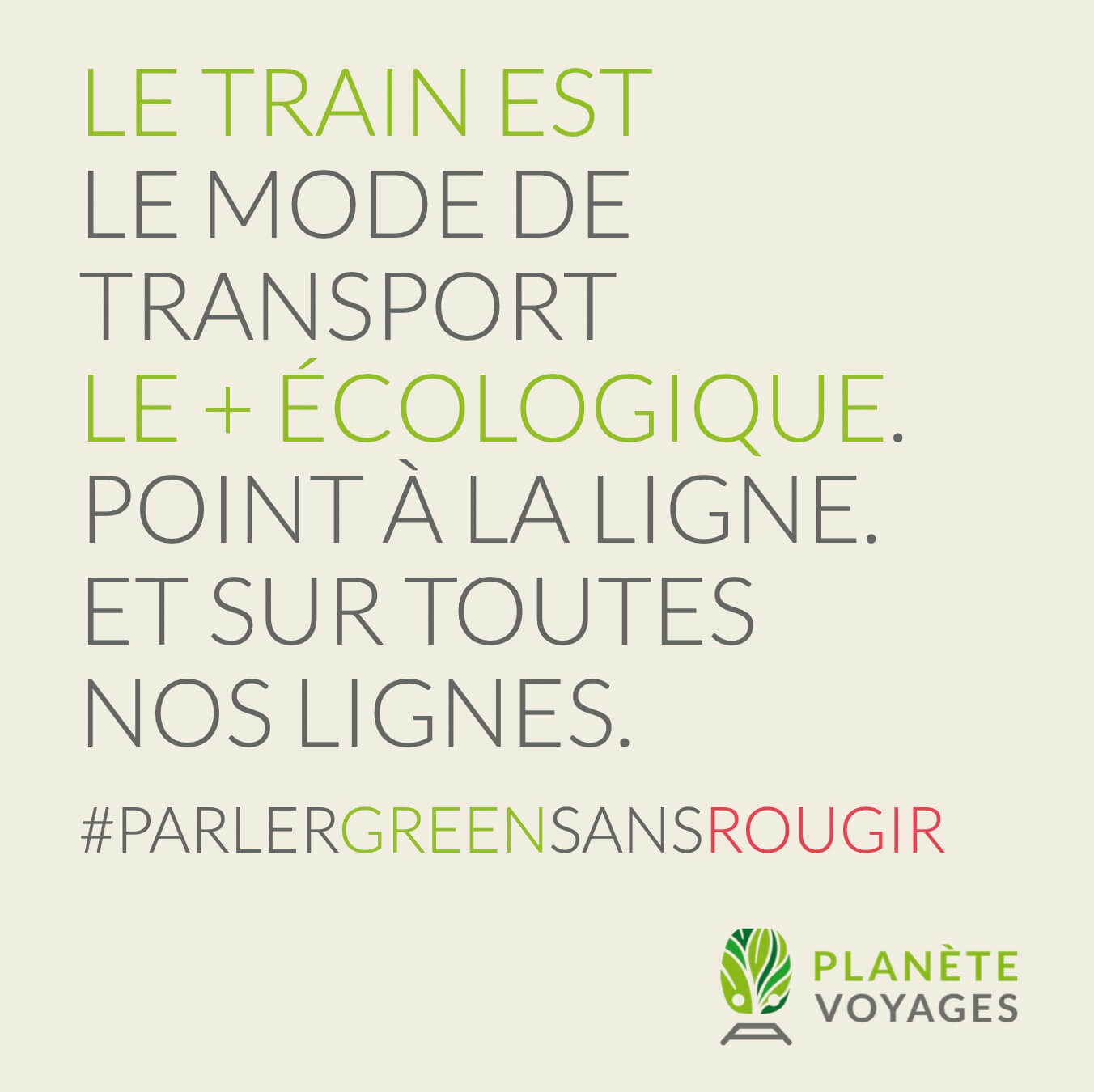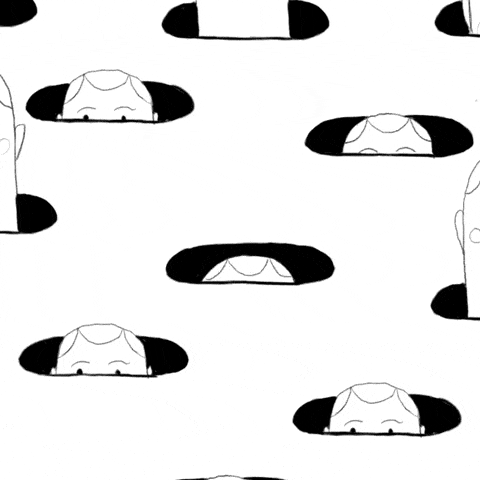Refashion : mode circulaire

Refashion : quand la mode passe en mode circulaire
L’éco-organisme qui recoud les fils d’une filière textile plus responsable
Bienvenue dans les dessous (réparables) du textile.La mode change, et heureusement. Car s’il y a bien une industrie qui laisse une empreinte XXL sur notre planète, c’est celle du textile. Entre surproduction, gaspillage et tonnes de déchets, il était grand temps de repasser à l’action.
Et c’est là qu’intervient Refashion, l’éco-organisme chargé d’orchestrer la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) dans la filière Textile d’Habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC). Avec un objectif simple mais ambitieux : transformer une industrie polluante… en moteur d’économie circulaire.
Le contexte textile : derrière l’étiquette, un vrai défi environnemental
👉 Chiffre clé : 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sont émises chaque année par l’industrie textile, soit 2 % des émissions mondiales.
Et en France ? En 2023, ce sont 3,2 milliards de pièces (soit 833 000 tonnes) de TLC qui ont été mises sur le marché.
Mais seulement :
- 32 % ont été collectées par des opérateurs agréés par Refashion
- 23 % ont été triées en vue de leur revalorisation
Autrement dit : la majorité des vêtements finit encore à la poubelle, dans les placards… ou en fin de cycle peu vertueuse.
Refashion, le chef d’orchestre de la circularité textile
Refashion n’est pas un acteur comme les autres. C’est l’éco-organisme agréé par l’État qui coordonne la filière REP textile. Son rôle ? Mettre en mouvement tous les acteurs pour réduire l’impact environnemental du textile tout au long de son cycle de vie.
Ses missions clés :
- Organiser et financer la collecte, le tri et le traitement des textiles usagés
- Soutenir les opérateurs du tri, les collectivités et l’ESS
- Encourager les marques à éco-concevoir leurs produits (via des éco-modulations)
- Promouvoir la réparation, le réemploi et le recyclage
- Sensibiliser les citoyens à la consommation responsable (les fameux 4R : Réduire, Réparer, Réutiliser, Recycler)
Comment ça fonctionne, concrètement ?
Toute entreprise qui met sur le marché français des produits TLC doit verser une éco-contribution à Refashion. En retour, Refashion prend en charge :
- La gestion de la fin de vie des produits
- La redistribution des fonds pour activer toute la chaîne de circularité
🔍 Zoom sur la répartition de 100 € d’éco-contribution (budget prévisionnel 2025) :
| Poste de dépense | Pourcentage |
| Collecte, tri, traitement |
28 % |
| Éco-modulations (bonus/pénalités) |
22 % |
| Soutien aux collectivités locales |
13 % |
| Frais de fonctionnement |
10 % |
| Accompagnement des parties prenantes |
7 % |
| Fonds de réparation |
7 % |
| Fonds de réemploi |
5 % |
| Communication & sensibilisation |
4,5 % |
| Recherche & développement |
3 % |
| Redevances ADEME |
0,5 % |
👉 Chiffre clé : Objectif 2028 = 60 % de collecte des TLC mis en marché (contre 32 % aujourd’hui)
Les flux du textile français : que deviennent les vêtements triés ?
- 85 % sont triés en France, 15 % à l’étranger
- Une partie est réemployée ou revendue
- D’autres sont transformés (chiffons, isolants, etc.)
- Une fraction reste non valorisée, faute de solutions
Problème : certains textiles sont toujours collectés hors filière (non conventionnés), mal triés ou incinérés. Refashion travaille à structurer ces points faibles.
Pourquoi c’est stratégique pour les entreprises de mode & textile ?
1. Une obligation réglementaire
Refashion agit sous l’égide des ministères de la Transition écologique et de l’Économie. L’adhésion est obligatoire pour tous les metteurs en marché. Et le cahier des charges 2025–2028 est strictement contrôlé.
2. Un levier de transformation produit
Avec les éco-modulations, plus un produit est éco-conçu (durable, recyclable, réparable…), plus la marque est incitée financièrement.
Vous pouvez être pénalisé ou récompensé selon votre engagement !
3. Un soutien à l’écosystème
Refashion finance :
- Les acteurs de l’ESS
- Les réparateurs
- Les centres de tri automatisés
- Les projets de recherche circulaire
C’est aussi une plateforme de collaboration entre industriels, distributeurs, collectivités et associations.
Et pour les consommateurs ? Sensibiliser pour mieux (ré)agir
Refashion ne parle pas qu’aux marques. Il parle aussi aux citoyens. Ses campagnes pédagogiques mettent en lumière :
- Les bons gestes de tri
- L’intérêt de la réparation
- Les bonnes pratiques d’achat durable
🎯 Objectif : changer les usages pour changer le modèle.
Conclusion : Refashion, l’allié (et le miroir) de la filière textile
Si la mode se démode, la circularité, elle, est là pour rester.Avec Refashion, la France s’est dotée d’un outil puissant pour repenser la filière TLC, de la conception jusqu’au dernier bouton.
Pour les entreprises, c’est une obligation légale… et une chance stratégique : celle de se différencier, de réduire leur empreinte, et de s’inscrire dans un modèle réellement responsable.
Vous êtes acteur de la filière textile et vous souhaitez aligner vos pratiques avec la REP ?
Chez Hyssop, on vous accompagne :
- Audit de conformité REP TLC
- Stratégie d’éco-conception & circularité
- Accompagnement communication responsable
- Feuille de route produit & filière
👉 Prenons le temps de recoudre tout ça ensemble
#Refashion #REP #TextileResponsable #ÉconomieCirculaire #ModeDurable#EcoContribution #TriTextile #RecyclageTLC #RSE #GreenFashion
Envie d’en savoir plus sur l’économie circulaire ou d’être accompagné dans votre démarche?
Contactez Hyssop dès aujourd’hui pour apprendre à faire mieux avec moins ensemble.
Anti-sèche : découvrez notre cahier pratique Économie circulaire.
Un condensé de bases pour commencer, méthodologie, actions concrètes et faciles à activer, des témoignages d’acteurs précurseurs pour que notre monde tourne plus rond.
Lectures d’été : notre sélection écolo, engagée et éclairante
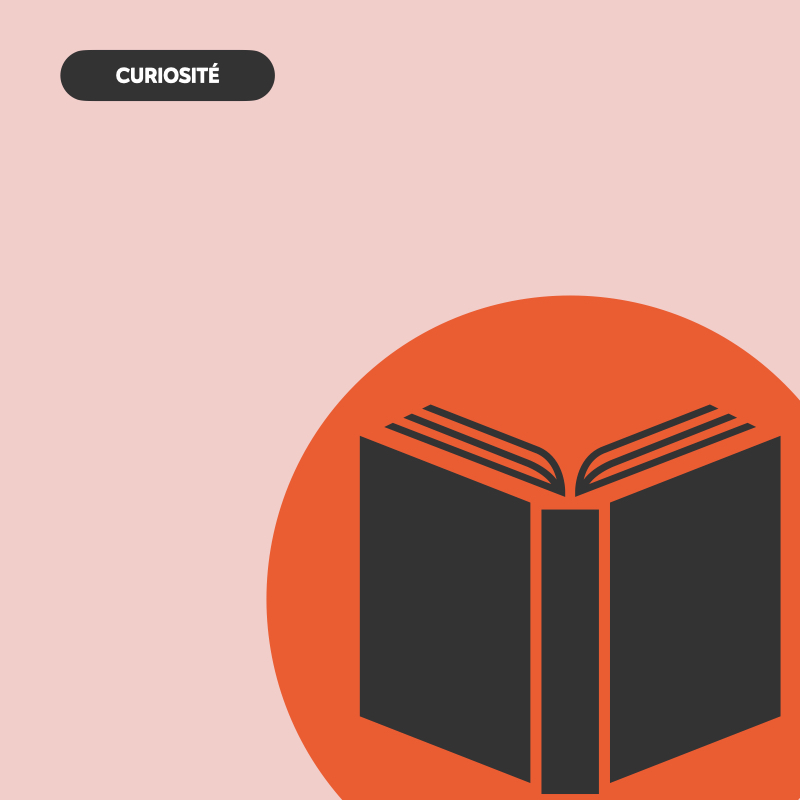
Suggestions de lecture pour l’été : on reprend les bases (et on muscle son cerveau vert)
Vous pensiez poser le cerveau cet été ? Pas de bol, on vous propose de l’allumer… mais en douceur, à l’ombre d’un arbre 🌳 (qu’on espère encore debout). Voici nos incontournables estivaux : des lectures pour comprendre le monde, imaginer des alternatives, respirer un peu d’espoir et s’armer de convictions pour la rentrée.
🌱 Comprendre les racines de la vie (et pourquoi elle déraille)
📗 L’avenir de la vie – Edward O. WilsonUn monument. Wilson, pape de la biophilie, retrace l’origine et la complexité du vivant. Une lecture essentielle pour se reconnecter à la nature sans ouvrir TikTok.
📘 Tout comprendre ou presque sur la biodiversité – Philippe GrandcolasAccessible, rigoureux et même drôle par moments (si si), un bon résumé pour briller en soirée ou sur la plage quand on vous demande « la biodiversité c’est quoi exactement ? »
📘 Printemps silencieux – Rachel CarsonLa claque. Ce texte de 1962 a lancé l’écologie moderne en dénonçant les ravages des pesticides. À faire lire à tous les Dup… enfin vous voyez.
📙 Les limites à la croissance – Donella et Dennis MeadowsLe rapport qui disait déjà tout en 1972, qu’on a superbement ignoré depuis. Bonne nouvelle : il a été actualisé en 2022, mais l’heure tourne toujours.
🌍 Climat : l’heure est grave (mais pas désespérée)
📕 Le grand livre du climat – Greta ThunbergUn pavé collectif mais passionnant, où Greta passe le micro à des dizaines de scientifiques. Un bon moyen d’élargir son horizon militant.
📗 Les orphelins de la planète – Jouzel, Grandjean, HenryUn panorama intelligent, nuancé, où l’on parle écologie ET justice sociale. Un trio d’auteurs majeurs pour un livre majeur.
📘 Plan de transformation de l’économie française – The Shift ProjectUn programme clair, chiffré, costaud : comment réorienter notre économie pour rester sous 2 °C sans retourner à la bougie.
🔍 Approfondir (et parfois s’indigner)
📕 La guerre des métaux rares – Guillaume PitronL’autre face de la transition « verte » : dépendances minières, tensions géopolitiques… indispensable pour éviter les angles morts.
📗 De la terre à l’assiette – Marc DufumierAgriculture, alimentation et solutions concrètes. Si vous pensiez que bio = bobo, ce livre va vous réconcilier avec le bon sens paysan.
📙 Les émotions de la Terre – Glenn AlbrechtEt si on se connectait à nos émotions pour changer le monde ? Ce philosophe australien parle de solastalgie, d’amour pour la Terre, et d’espoir.
📘 Vortex – Testot & WallenhorstUn OVNI éditorial entre BD et essai. Dense, dérangeant, mais brillamment stimulant. À ne pas lire au bord d’un volcan.
📗 L’économie symbiotique – Isabelle DelannoyEt si notre futur s’inspirait des écosystèmes ? Une lecture inspirante pour réconcilier économie et vivant (spoiler : c’est possible).
📘 Voie de passage – Laurent Berger & Benoît BazinQuand le social dialogue avec l’économie durable, ça donne un échange humain, humble, lucide. Un livre rare dans le débat public.
📙 Accélération – Hartmut RosaUn essai philosophique sur notre frénésie de vitesse. Parfait pour lire lentement pendant vos vacances (si vous en avez).
📕 Humus – Gaspard KoenigUne fable agricole et politique à la fois, où l’on suit deux visions du monde qui s’affrontent autour du sol, de l’agriculture et du vivant. Brillant, engagé, et plein d’ironie bien placée.
🌳 Et parce qu’on a aussi besoin de rêver…
📕 Dans la forêt – Jean HeglandUn roman post-effondrement plein de poésie. Deux sœurs, une cabane, un monde en ruines, et pourtant… beaucoup de lumière.
📗 L’arbre monde – Richard PowersFresque magistrale sur le lien entre humains et arbres. Une lecture foisonnante, presque mystique. Arbre approuvé.
📘 La fin des hommes – Christina Sweeney-BairdUn roman prémonitoire sur une pandémie foudroyante. Pas très feel good, mais incroyablement bien écrit.
📙 Urgence climatique, il est encore temps – Casterman BDUne BD claire, drôle et pédagogique. Le cadeau idéal pour sensibiliser sans braquer.
✨ Lire pour comprendre, pour ressentir, pour agir
Chez Hyssop, on est convaincus qu’il faut nourrir la tête pour transformer les pratiques. Cette sélection n’est pas qu’un empilement de bouquins à lire sur la plage, c’est une boussole pour penser la transition, l’habiter, la transmettre. Lire, c’est déjà résister. Lire, c’est déjà s’engager.
#LecturesÉcologiques #Biodiversité #TransitionÉcologique #Climat #RSE #ÉtéEngagé #ÉconomieDurable #LivresResponsables
Pétition loi Duplomb : pourquoi signer, même maintenant
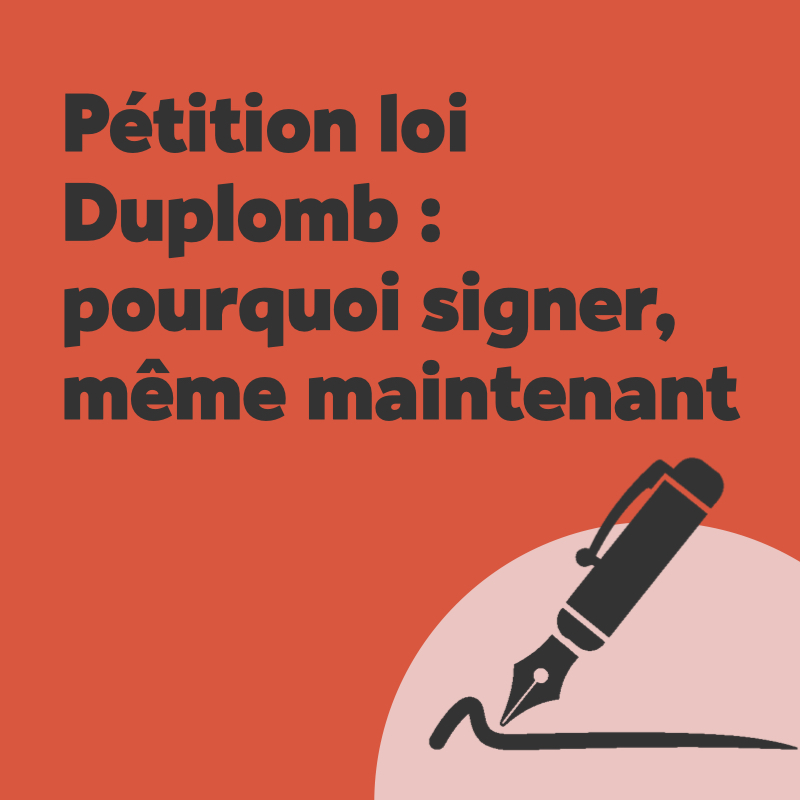
Loi Duplomb : pourquoi (et comment) signer la pétition qui fait trembler l’Assemblée ?
Presque 2 millions de signatures en deux semaines, des débats enflammés et une loi déjà adoptée… Vous vous demandez si ça vaut encore le coup de signer la pétition contre la loi Duplomb ? On vous explique pourquoi oui, c’est même plus que jamais le moment de le faire — et comment, en un clic, vous pouvez vous joindre à la plus grosse mobilisation citoyenne jamais vue en ligne.
📜 La pétition, née dans l’urgence… et portée par l’indignation
Le 10 juillet 2025, deux jours seulement après le dépôt de la proposition de loi Duplomb, Éléonore PATTERY lance une pétition sur la plateforme officielle de l’Assemblée nationale. Le texte de loi, jugé dangereux pour plusieurs garanties sociales et environnementales, provoque une onde de choc.
➡️ En quelques semaines, la pétition frôle les 2 millions de signatures.➡️ Du jamais-vu depuis l’ouverture de la plateforme officielle.
Mais attention : le compteur ne suffit pas. Pour que la pétition ait un impact politique, elle doit continuer à faire pression. Et c’est là que chaque signature compte.
🧨 Mais au fait, c’est quoi cette loi Duplomb ?
Adoptée début juillet 2024, la loi Duplomb modifie profondément la manière dont les normes environnementales sont débattues et appliquées en France. Concrètement, elle vise à accélérer les procédures administratives pour certains projets industriels… au prix de sérieux reculs pour la santé publique et la protection de l’environnement.
Parmi les points les plus controversés :
- Elle réduit le pouvoir des ONG et des citoyens dans les enquêtes publiques environnementales.
- Elle autorise des dérogations encadrées aux normes environnementales existantes, notamment dans l’usage de certains pesticides suspectés d’être cancérogènes.
- Elle affaiblit les contre-pouvoirs institutionnels, comme le rôle de l’Autorité environnementale ou celui des préfets.
Les experts alertent : cette loi pourrait faciliter la réintroduction de substances dangereuses, sous couvert de compétitivité économique. Et ce, alors même que les liens entre pollution chimique et hausse des cancers pédiatriques, notamment dans les zones agricoles, sont de plus en plus documentés.
🧭 Une pétition peut-elle vraiment bloquer une loi ?
La réponse est nuancée, mais encourageante.
✅ Non, une pétition ne suspend pas automatiquement une loi déjà adoptée.✅ Mais oui, elle peut forcer un débat à l’Assemblée nationale.Et ce débat peut mener à :
- une nouvelle proposition de loi pour abroger la précédente ;
- une pression directe sur la majorité présidentielle, notamment par les députés eux-mêmes.
Or, toute nouvelle proposition de loi doit passer… par un vote majoritaire. D’où l’enjeu d’une mobilisation massive et durable : plus on signe, plus on pèse.
🛡️ Attention aux intox : la vérité sur les “fausses signatures russes”
Dans un climat tendu, plusieurs rumeurs ont circulé sur des signatures venues de bots ou de l’étranger — en particulier, de Russie.
👉 La réalité ? La plateforme officielle est liée à FranceConnect, le service de connexion sécurisé de l’État. Il est impossible de signer une pétition sans être identifié via vos impôts, votre assurance maladie ou votre compte La Poste.
✅ Donc non, cette mobilisation n’est pas gonflée artificiellement.✅ Oui, chaque signature compte, et la vôtre aussi.
🖱️ Comment signer la pétition contre la loi Duplomb en 1 clic , ou :
- Rendez-vous sur la plateforme officielle des pétitions de l’Assemblée nationale :👉 https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1502
- Cliquez sur “Soutenir cette initiative”.
- Connectez-vous via FranceConnect (impots.gouv, Ameli, La Poste…).
- C’est fait ! Vous rejoignez les 2 millions de citoyens qui ont décidé de ne pas laisser passer.
⚠️ Ne signez que via ce lien officiel. Plusieurs fausses pétitions circulent actuellement sur les réseaux sociaux, non reconnues par l’Assemblée nationale.
✊ Pourquoi signer maintenant (même si vous êtes en retard) ?
Parce que le combat continue. Parce que rien n’est figé.Et surtout, parce qu’en 2025, la pression citoyenne est une arme politique redoutable.
Signer, c’est :
- envoyer un message clair aux élus ;
- montrer que la société civile ne dort pas ;
- et garder ouverte la possibilité d’une marche arrière politique.
En résumé : signer, c’est utile. Et urgent.
✅ La pétition ne bloque pas automatiquement la loi.✅ Mais elle force un débat, crée de la pression, et peut aboutir à une abrogation si la mobilisation se poursuit.
Et vous, vous attendez quoi pour ajouter votre nom à la liste ? ✍️
#LoiDuplomb #PétitionCitoyenne #DémocratieActive #Mobilisation #FranceConnect #EngagementCitoyen #PressionPolitique #LoiEnvironnement #AssembléeNationale
Hyssop x The Good Company : l'alliance du Good

The Good Company se rapproche du cabinet conseil Hyssop pour compléter son expertise RSE
L’agence de communication responsable The Good Company annonce son rapprochement stratégique avec Hyssop, cabinet conseil en stratégie RSE et développement durable. Cette prise de participation minoritaire dans Hyssop permet de proposer aux entreprises une offre complète, de la stratégie RSE à la communication responsable, en passant par la mise en œuvre opérationnelle.
Un accompagnement global des entreprises en transition
Depuis 5 ans, Hyssop accompagne des organisations dans l’identification, la structuration et l’activation de leur stratégie RSE. Cabinet de conseil reconnu, il travaille avec des acteurs comme LVMH, SNCF, WWF ou encore Bpifrance sur des sujets aussi cruciaux que la double matérialité, la conformité CSRD, les achats responsables ou encore la mobilisation des parties prenantes.
De son côté, The Good Company est engagée depuis 2019 dans une démarche de communication durable, avec des clients tels que Macif, Monoprix, CNP Assurances ou Sidaction. L’agence s’est donnée pour mission de rendre le responsable désirable, en alliant créativité, exigence stratégique et alignement avec les enjeux sociétaux.
Ce partenariat permet aujourd’hui d’offrir un accompagnement RSE à 360°, depuis l’audit des enjeux ESG jusqu’à la construction d’une communication sincère, engageante et différenciante.
De la stratégie à la preuve, de la preuve à l’expression
Dans un contexte de vigilance accrue des consommateurs et des régulateurs face au greenwashing, The Good Company et Hyssop partagent une même conviction : la communication ne peut être pertinente que si elle repose sur des engagements concrets et mesurés.
“Depuis 5 ans notre combat est l’alignement avec ses vrais enjeux. Nous avons développé des outils et des méthodes pour aider les clients à identifier, et prioriser leurs enjeux. Nous bâtissons ensuite des roadmaps pour qu’ils construisent les preuves de leur engagement. Le story making, avant le story telling” déclare Dominique Royet, DG d’Hyssop.
Grâce à cette alliance, les deux structures renforcent leur capacité à accompagner les entreprises dans leur transition écologique et sociétale, tout en leur offrant les outils pour la raconter de manière crédible et accessible.
Une collaboration qui devient officielle
Après deux ans de projets partagés, de bureaux communs au sein de la “House of Good” et de missions conjointes (LVMH, CNP Assurances, Upcoop…), The Good Company et Hyssop officialisent leur partenariat stratégique.
« Nous sommes convaincus que la RSE n’est pas seulement un outil de communication, mais un levier de transformation pour les entreprises. Le cabinet Hyssop nous aide à traiter le fond avant la forme, et c’est pourquoi ce partenariat est une évidence. Leur expertise, combinée à notre savoir-faire en communication, permet à nos clients de prendre des engagements concrets et visibles, tout en se différenciant par une communication toujours aussi créative. », déclare Luc Wise, Président de The Good Company.
#stratégieRSE #cabinetconseilRSE #communicationresponsable #greenwashing #accompagnementESG #doublematérialité #CSRD
Devenez "Entreprises Engagées pour la Nature"
Entreprises engagées pour la Nature
Depuis un an, l’Office français de la biodiversité nous a confié, en partenariat avec les écologues d’ACTeon environment et en résonance avec la Stratégie Nationale Biodiversité présentée le 27 Novembre 2023, l’évaluation des roadmaps biodiversité des entreprises engagées dans le programme Entreprises Engagées pour la Nature.
Ce programme a pour ambition d’engager les entreprises en faveur de la biodiversité. Il vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d’actions d’entreprises. Il s’adresse aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, initiées ou débutantes en matière de biodiversité et qui veulent s’engager concrètement.
Après avoir travaillé sur une cinquantaine de roadmap d’entreprises de 5 à 5000 personnes, nous sommes capables de dire que ce programme est une excellente façon de donner un cap à l’entreprise mais aussi de pouvoir bénéficier de conseils avisés.
Dans la Stratégie Nationale Biodiversité, l’Etat a donné un objectif de 5 000 entreprises engagées pour la Nature, soyez donc parmi les premiers et donnez-vous une chance de pouvoir bénéficier de toutes les opportunités qu’offre un plan d’action biodiversité.
Plan Sobriété Énergétique : c'est quoi ?
Plan de sobriété énergétique
Le plan de sobriété énergétique est (enfin) une initiative du Gouvernement pour accélérer les efforts des entreprises & collectivités en matière de consommation d’énergie. Paradoxalement, il aura fallu attendre une guerre pour que les politiques bougent les lignes de l’énergie…
Alors que le GIEC alerte sur l’état actuel du climat et que la situation en Ukraine ne se stabilise toujours pas, l’abondance énergétique telle que nous l’avons connue n’a jamais été autant en péril.
Emmanuel Macron l’avait annoncé le 14 juillet dernier « On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété […]. On va préparer un plan pour se mettre en situation de consommer moins. ». Elisabeth Borne, première ministre, a donné plus de détails sur ce plan. Enfin ! ça y est, on va passer aux choses sérieuses !
Sobriété énergétique d’accord… mais qu’est ce que c’est ?
Contrairement à l’efficacité énergétique (mieux gérer ses consommations et améliorer ses équipements pour qu’ils soient moins énergivores, tout en maintenant le même confort de vie), la sobriété énergétique c’est : prendre des mesures de réduction nette des consommations d’énergies, par des changements de comportements, de mode de vie et d’organisation collective.
Quel est l’objectif du Plan ?
Réduire la consommation d’énergie de 10% d’ici 2024 et de 40% d’ici 2050 en fonction de 2019, année de référence. Cela pour enrayer les dépenses énergétiques qui ne sont pas indispensables et réduire l’impact carbone.
Pourquoi maintenant ?
D’abord parce qu’il y a urgence à cause de la crise énergétique liée à la guerre, que les centrales nucléaires sont en maintenance mais aussi et surtout parce qu’on est clairement pas en avance au niveau sobriété énergétique…
Tout cela fait craindre une pénurie de gaz et des difficultés d’abondance électrique. Bref, en terme d’énergie, l’hiver risque d’être très chaud, du moins…très froid…enfin l’hiver sera chaud parce qu’il fera froid.
Elisabeth Borne assurait en août dernier que les ménages ne seraient pas concernés par les coupures de gaz. Ce serait les entreprises très consommatrices, qui pourraient subir des coupures . Pour l’électricité en revanche, des coupures sont plus sûres, de deux heures, quartier par quartier.
Pour éviter ça, le gouvernement mise sur son plan de sobriété énergétique, et tente ainsi de s’aligner avec les enjeux environnementaux auxquels nous faisons face. Après avoir demandé aux Françaises et aux Français de participer à l’effort collectif en appliquant des gestes au quotidien pour économiser l’énergie, le gouvernement demande aux entreprises de s’engager dans cet effort. Qu’il s’agisse d’éviter une pénurie ou de s’aligner un peu plus avec l’Accord Climat de Paris de 2015 qui prévoit d’atteindre une neutralité carbone d’ici 2050, la France doit considérablement diminuer sa consommation d’énergie.
Ok et on en est où aujourd’hui ?
L’ambition de la France en terme de sobriété énergétique est importante et l’hexagone est en retard. Le rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat évoque une progression insuffisante face au changement climatique, à cause d’un manque « d’objectifs stratégiques, de moyens et de suivi ». L’instance indépendante qui évalue la politique climatique du gouvernement français appelle l’État à un « sursaut ». Pour rappel, le Conseil d’État avait condamné la France en 2021 pour « inaction climatique ».
Enfin, les résultats aux dernières élections présidentielles montrent clairement que les Françaises et les Français demandent une prise de conscience urgente de la part de l’État et des autres acteurs politiques, face aux changements climatiques.
La France n’est pas la seule a avoir de belles et grandes ambitions, l’Europe aussi avec son programme « Green Deal ». L’Europe revoit d’ailleurs son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), prévue à 40% pour 2030, elle est aujourd’hui à 55%, par rapport à l’année de référence 1990, avec toujours pour objectif de devenir le premier continent neutre en carbone d’ici 2050.
Concrètement ?
Des actions pour consommer moins d’énergie sont déjà prévues : le 1er octobre prochain, les gares, les aéroports ainsi que les stations de métro devront couper les publicités des écrans numériques si une « forte tension » se faisait ressentir par le gestionnaire du réseau électrique.
Sur le même principe que le « Green Deal » de l’Europe, la France prévoit des objectifs de réduction des GES pour chaque secteur d’activité. Ces derniers devront établir une feuille de route avec un calendrier précis des mises en oeuvre de leurs actions. Dès septembre, 3 premiers grands secteurs seront concernés par des discussions : les forêts, l’eau et la production d’énergie décarbonée (nucléaire et renouvelable).
Aussi, six groupes de travail (administration, entreprises, collectivités territoriales, établissements recevant du public, logement et numérique) ont été lancés afin d’élaborer un plan cohérent et réalisable. Les conclusions de leurs efforts seront publiées à la fin du mois de septembre 2022.
Pour les acteurs publics ça veut dire quoi ?
Différentes pistes de réflexion autour du plan de sobriété énergétique sont en cours. Avec en tête de liste « accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics par l’amélioration de leur performance énergétique. Rappelons que le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie consommée en France. Comment ? Grâce à 6 principaux travaux :
- l’isolation du toit (25 à 30% des déperditions énergétiques) ;
- l’isolation des murs (25% des pertes de chaleur) ;
- l’isolation des fenêtres (10 à 15% des déperditions thermiques);
- l’isolation des sols (7 à 10% de gaspillage énergétique évité) avec notamment les caves, les garages, le dessous des carrelages et des parquets ;
- le changement de la ventilation ;
- le remplacement des systèmes de chauffage (installation de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au fioul ou au gaz).
Une autre mesure évoquée est de limiter la consommation et de permettre aux plus précaires d’en bénéficier, par des fermetures occasionnelles de bâtiments publics, du télétravail serait alors mis en place.
Pour les entreprises, qu’est ce qu’on fait ?
La voiture est aujourd’hui le moyen de transport privilégié pour les déplacements entre le domicile et le travail (la voiture représentait 70,8% de ces déplacements en 2020). En réponse, le forfait mobilités durables (FMD) devrait être étendu à la rentrée. Il sera cumulé au remboursement partiel d’un abonnement de transports en commun (même si les déplacements annuels sont inférieurs à 100 jours) pour inciter les salariés à modifier cette habitude et diminuer leur impact.
Lors de son dernier discours à l’université d’été du Medef, Elisabeth Borne a annoncé quelques actions adressées aux entreprises :
– établir en septembre son propre plan de sobriété ;
– nommer un ambassadeur de la sobriété (sur le modèle des référents Covid) ;
– accompagner les salariés vers l’adoption de mobilités plus propres et à l’adaptation des moyens de déplacement. Les entreprises doivent également favoriser « les nouvelles façons de travailler », en incitant par exemple au télétravail.
Hyssop, AGENCE DE CONSEIL EN RSE peut vous accompagner sur ce sujet.
Et si ce n’est pas suffisant ?
Selon l’état et l’urgence de la situation, plusieurs actions seront mises en place de manière progressive :
1) mise en place de mesures axées sur la sobriété ;
2) limitation de la consommation de gaz ;
3) coupures de gaz et d’électricité.
Sources :https://bonpote.com/5-ans-apres-peut-on-dire-que-laccord-de-paris-na-servi-a-rien/
https://www.greenly.earth/blog-fr/tout-comprendre-sur-le-plan-de-sobriete-energetique-a-venir?utm_term=&utm_campaign=perf-max-fr&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndggjB2BusuhLE8JyoLNeQlpdIid4FVoEqMeX9yM6_Nx4ZtSRmMbg9URoCK8AQAvD_BwE
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/08/30/elisabeth-borne-affirme-qu-il-n-y-aura-pas-de-coupure-de-gaz-chez-les-menages-francais-en-cas-de-penurie_6139552_823448.html
https://www.europe1.fr/politique/plan-de-sobriete-energetique-que-prevoit-le-gouvernement-4131161
https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1513957-sobriete-energetique-des-entreprises-ce-que-l-on-sait/
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/280850-sobriete-energetique-plus-de-teletravail-cet-hiver
http://www.virage-energie.org/fiches-pedagogiques/la-sobriete-energetique/
The Good parle de nous
Hyssop, l'agence RSE résiliente, stimulante et essaimante
Un créa, un stratège et une des pionnières du développement durable en France se sont unis il y a deux ans pour créer une agence de conseil RSE qui connaît un succès fulgurant.
Ils se sont lancés par conviction et non par opportunisme. « Vous savez, notre carrière est plutôt derrière nous mais nous avions, tous les trois, envie de donner encore plus du sens à ce que nous faisions, nous raconte Guillaume Gozé. Selon l'ONU, il nous reste 10 ans pour réagir. Mais à force de le répéter, on perd un temps fou. Alors on ne le dit plus : on le fait. L'avenir, on y croit dur comme faire et c'est pour cela que nous avons créé Hyssop avec Dominique Royet et David Garcia. » Ces « trois mousquetaires » de la RSE ont des CVs qui parlent d'eux-mêmes. Directeur de la communication d'Eurostar pendant plus de 7 ans, Guillaume Gozé a ensuite été directeur stratégique de Saguez et Partners pendant un autre « septennat » avant de partir aux Etats-Unis pour prendre les commandes du bureau de l'agence américaine Kettle à San Francisco. David Garcia est un concepteur rédacteur spécialisé dans la communication durable qui a près de vingt ans d'expérience derrière lui et qui a travaillé pour de nombreuses agences dont Fullsix, Ogilvy, Publicis, Sidièse et monsieurdavidgarcia.com. Dominique Royet est, elle, une des pionnieres du développement durable en France. Après un début de carrière chez Disney en tant que responsable des licences et des partenariats, elle a rejoint WWF en 1999 pour développer pendant 9 ans les partenariats avec les entreprises et piloter la communication de l'ONG en France. Avec Carrefour, elle est notamment parvenue à imposer le label FSC de bonne gestion forestière dans l'hexagone. En 2008, elle a co-créé un cabinet conseil en développement durable, Greenflex, où elle a accompagné pendant 4 ans des PME et des ETI dans leurs stratégies RSE. Après une expérience d’innovation sociétale au sein d’Alternatives et Alliances, elle prend en 2015 la direction du label Max Havelaar en France. Ce parcours sans faute n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. « J’ai passé 18 ans de ma vie à prêcher dans le désert, nous avoue-t-elle, mais depuis 2 ans, je sens vraiment que le vent souffle dans la bonne direction…».
L’agence que les partenaires ont fondée en octobre 2020 repose sur les trois piliers de compétence. « Dominique dirige les diagnostics et les plans d’action RSE pour nos clients, explique Guillaume Gozé. Je suis, de mon côté, plus spécialisé dans la stratégie de marque et David est notre directeur de création qui orchestre les campagnes. Avoir ces trois activités sous une seule et même ombrelle est assez rare mais cela permet d’offrir une vision globale à nos clients. Notre unique objectif est d’avoir un impact. Nous ne sommes pas dans le story-telling mais dans le story-proving ».
La crise sanitaire n'a pas empêché Hyssop, qui tire son nom de l'hysope qui est une plante résiliente, stimulante et essaimante, d'attirer rapidement des clients prestigieux. Guerlain, Renault, BHV et SNCF lui ont déjà fait confiance. Mais ce nouveau venu dans le paysage parisien du conseil RSE ne cherche pas à grossir coûte que coûte. « Nous refusons actuellement deux clients par mois car si nous ne pouvons pas avoir d'impact, nous préférons ne pas collaborer avec eux, résume Dominique Royet. Nous sommes aujourd'hui six salariés et nous ne souhaitons pas être 25. Nous voulons rester une agence de seniors impliqués sur tous les projets. » Les carnets d'adresse très épais des trois co-directeurs leur permettent de faire appel à des spécialistes lorsqu'ils en ont besoin. Et puis la taille ne fait pas le bonheur. « Avoir un impact nous rend heureux, juge l'ancienne CEO de Max Havelaar France. Nous tentons toujours de faire des campagnes belles, drôles et intéressantes car ce sont elles qui ont le plus d'impact. La RSE doit être désirable ». Le souhait le plus cher de cette militante de la première heure est de ne plus avoir de travail dans les années à venir. « Hyssop est appelé à disparaître, prévoit-elle, car à terme la RSE devra intégrer tous les métiers de l'entreprise et nos clients n'auront alors plus besoin de nous. Mais cela ne nous dérange pas. Bien au contraire. » Quand on vous dit que ces trois partenaires ne sont pas motivés par l'appât du gain…
Par Frédéric Therin, The Good.
Après le Social Branding : le Sustainable Branding
Il y a quelques années, je dirigeais des équipes de designer pour Apple en Californie. Notre seule obsession : le Social Branding. Imaginer des systèmes visuels uniques et puissants, capable de différencier Apple sur les divers réseaux sociaux, afin d’émerger parmi la foultitude de messages et d’offres concurrentes.
Nous passions autant de temps et d’énergie sur le fond que sur la forme. Du vrai branding au sens noble du terme, celui qui ne se limite pas juste à l’emballage (le dessin) mais qui intègre dès l’amont une réflexion stratégique pour dégager une idée force autour d’un produit ou service (le dessein).
Un exemple : la refonte de l’App Store.
D’abord une idée centrale - passer d’un magasin d’Apps à un magazine quotidien sur les Apps- puis un système graphique élaboré et propriétaire. Un double chantier donc : d’un côté changer de métier pour devenir curateur d'applications avec des critères de sélection précis, une ligne éditoriale stricte, la formation des rédacteurs… et d’un autre côté la création de codes graphiques puissants mais suffisamment flexibles pour assurer reconnaissance et émergence dans le temps, éviter la lassitude, et donner la part belle aux Apps. Le résultat visible est une toute nouvelle app qui pousse 5 applications par jour, avec un habillage fort basé sur le “chicklet”, ce carré que l’ont retrouve sur l’app et sur les réseaux sociaux, décliné à l’envi selon les catégories produits et les sujets. Le résultat moins visible, un nouveau business modèle qui donne plus de la valeur à l’App Store, déjà très gros contributeur dans les revenus du géant américain.
Aujourd’hui chez Hyssop, sur les sujets RSE, la recette n’est pas différente.
Il s’agit dans un premier temps d'accompagner les clients à avoir une vision, caler une ambition et définir une direction forte (versus un simple emballage séduisant). Cela implique de questionner le business model, d’interroger les réflexes, et de savoir changer le fond avant de vouloir travailler la forme. Bref, le story making avant le story telling.
C’est pour cela que tout chantier RSE chez nous commence par une phase d’analyse technique, un diagnostic poussé s’appuyant sur des référentiels éprouvés (ISO 26000 ou GRI) ou sur des analyses de cycle de vie quand nécessaire, pour comprendre là où résident les vrais impacts environnementaux, sociaux et sociétaux d’une marque. C’est ce travail d’analyse qui permet d’éviter le greenwashing, de déceler les opportunités business, et de définir une proposition stratégique forte. Ensuite seulement vient le temps des mots et des signes distinctifs, pour valoriser et magnifier l’idée ou le concept….
C’est tout cela que nous appelons le Sustainable Branding, une réflexion intégrée sur le fond et la forme au service de l’impact positif.
Rapport d'engagement 2021
Comme nous ne sommes pas cordonniers, nous avons souhaité bien nous chausser d'un rapport d'engagement qui fait le point, le bilan d'un année d'activité pour donner le LA de celle qui va suivre : ambitions, points d'amélioration et directions. Bonne lecture à vous !
À télécharger ici : Rapport d'engagement 2021 Hyssop
VIDÉOS - Rencontres inspirantes à Agir pour le Vivant
Pour ceux qui auraient raté le jeune et tout aussi fringant festival Agir Pour le Vivant, voici quelques morceaux choisis : nous y étions 😉. L'occasion pour nous de nous pencher sur notre rapport au Vivant (c'est quoi, le Vivant ?), et comment nous pouvons continuer à nous en émerveiller. Pour ça, il va falloir le préserver, le chérir, l'épanouir... comme il le faisait jadis finalement très bien sans nous, les humains.
En parlant d'humain, nous en avons croisé de fameux qui se mobilisent pour ce vivant : découvrez les anecdotes de Anne-Sophie Novel (journaliste), Cécile Lochard (Directrice développement durable Guerlain), Eugénie Lefebvre (Fondatrice et Directrice générale des Magasins généraux au sein de BETC), Marc Dufumier (agro-écologue), Philippe Zaouati (CEO de Mirova, entité spécialisée dans l'investissement responsable).
Les podcasts du BHV
“Ensemble vers un futur durable et désirable”. Tout au long de l’année, nous profitons des évènements du BHV Marais pour vous faire découvrir à travers ces podcasts des invités engagés pour un monde meilleur au travers de leur activité. Nous partagerons différents types de sujets qui nous inspirent pour aller vers un monde durable et désirable.
Jardin intérieur
Dans le cadre de l’opération « Jardinons » du BHV Marais, nous nous intéressons à la biophilie, cette connexion biologique avec la Nature dont chacun de nous a besoin. Les neurologues mesurent bien aujourd’hui le bien être procuré à l’être humain par la présence de nature. Mais au-delà des études, Hervé Brunon nous explique, avec cette poésie qui lui est propre, tout l’intérêt de ce jardin qui échappe par bonheur à notre contrôle pour le physique, le mental, mais aussi le lien social.
Hervé Brunon est Historien des jardins et du paysage et Directeur de recherche au CNRS.
Précieux Jardin
Dans le cadre de l’opération « Jardinons » du BHV MARAIS, nous mettons en évidence le rôle du Jardin dans la protection de la Nature et notamment de la biodiversité. 17 millions de jardins en France c’est 4 fois plus de surface que nos réserves naturelles. Ils sont des refuges du vivant. Jardins détente, jardins beauté, jardins nourriciers, Louis Albert De Broglie, gardien de biodiversité notamment au travers du conservatoire de la Tomate qui regroupe 700 espèces différentes, nous partage sa passion et son enthousiasme.
Louis Albert De Broglie, Le Prince Jardinier, Militant écologique, est Fondateur du Domaine de la Bourdaisière et entrepreneur avec Deyrolle.
L’océan des invisibles
Étudier et protéger l’océan, c’est prendre soin du système central de notre Planète. Dans le cadre de l’opération « Biarritz » du BHV MARAIS, nous nous intéressons au monde invisible de l’Océan. Il abrite une biodiversité composée de 95% de micro-organismes marins, essentiels pour l’alimentation mondiale car 1er maillon de la chaîne alimentaire mais aussi fournisseurs de 50% de l’oxygène. Après les micro-plastiques, l’équipage de Tara est parti à la découverte du Microbiome marin. Clémentine Moulin nous parle des expeditions de Tara mais aussi de la place des femmes dans le monde marin.
Clémentine Moulin est navigatrice et directrice des opérations pour la Fondation Tara océan. Elle nous invite à découvrir les secrets de l’océan qui font l’objet d’études scientifiques clefs pour la compréhension du climat.
Une seconde main pour le climat
Chaque année, ce sont 2 millions de tonnes de déchets qui sont liés à l’ameublement. Dans un contexte contraint où re-fabriquer génère des émissions de CO2 mais également des impacts environnementaux forts, il est nécessaire de repenser sa façon de meubler et embellir son univers quotidien sans pour autant salir la planète. Parmi les solutions, la seconde main est une vraie opportunité d’éviter les impacts et valoriser par ailleurs le commerce local.
Charlotte Cadé, Co-Fondatrice de SELENCY, brocanteuse 2.0, nous explique dans le cadre de l'opération « Re-création » du BHV MARAIS les avantages environnementaux et sociétaux de la plateforme de vente en ligne qui propose 200 000 meubles seconde main et permet à 2 millions de visiteurs par mois d’envisager une autre manière de décorer leur intérieur.
Go For Good tisse le futur
Le secteur de la mode est un des plus polluant et la catastrophe du Rana Plaza (effondrement d’une usine textile au Bangladesh en 2013) a mis en évidence les conditions difficiles dans lesquelles des ouvriers au bout du monde fabriquent nos vêtements à bas prix. Dans un tel contexte, il est fondamental de pouvoir faire évoluer la façon de fabriquer les vêtements, de les transporter et de prendre en compte les critiques et les attentes des consommateurs en la matière.
Damien Pellé, Directeur développement durable du Groupe Galeries Lafayette, nous explique dans le cadre de l'opération « Re-création » du BHV MARAIS comment une vieille dame de 120 ans réussit à faire évoluer le secteur du textile et de la mode.
TRIBUNE - Voyage au coeur du Vivant
Cet été HYSSOP n'a pas chômé. Mais c'était tout comme tellement tout était délicieusement nourrissant et passionnant : mieux qu'un bon roman à bouquiner sur sa serviette. Notre été s'est passé autour du vivant : un bien beau sujet que l'on a tenté de vous résumer ici.
La biodiversité, le vivant, sont au cœur de l’actualité en cette rentrée. Congrès mondial de la Nature à Marseille (UICN), Agir pour le Vivant à Arles, les événements qui lui sont consacrés se multiplient. Mais comment appréhender au mieux cette question du Vivant ? Dominique Royet, cofondatrice d’Hyssop, nous partage son expérience sur la question. À lire ici ou là sur l'excellent TheGood.fr.
1ère Escale : Le monde.
Sans valise hormis sous les yeux, mon voyage commence sur mon sofa par une lecture aussi éclairante qu’un franc soleil d’été. Nous sommes en Juin, le 10. Deux instances référentes que sont l’IPBES (pour la biodiversité) et le GIEC (pour le climat) signent un rapport commun qui alerte sur la nécessité de traiter conjointement ces deux enjeux, intimement liés dans le vivant mais séparés dans la vie. Sûrement trop tard pour mettre en coloc la Cop15 sur la biodiversité (Chine) & la Cop26 sur le climat (Ecosse). Comment ici interdire la déforestation d’écosystèmes qui stockent beaucoup de carbone tout en abritant une forte biodiversité. Comment planter là-bas toutes ces monocultures d’arbres n’importe où au nom de la compensation carbone détruit finalement la biodiversité. Comment j’ai été ébouriffée par tous ces liens biodiversité & climat, et comment cette biodiversité participe à la réduction des GES.
2ème Escale : Agir pour le vivant à Arles
Une pléiade d’intellectuels, d’écrivains, de sociologues, de philosophes se sont retrouvés pour la 2e édition de ce festival arlésien afin de partager avec nous leurs avis, leurs émotions, leurs concepts, leurs visions, parfois leur spiritualité lors des tables rondes sur ce thème qui sera celui de mon été : LE VIVANT. Quelques actions très intéressantes ont émergé aux détours des discussions : Nathan Stern qui promeut l’idée d’une « Ecodétaxe » (une TVA réduite pour les produits qui ont un impact moindre), Eva Sadoun qui nous invite à une conversion de l’économie vers un partage des communs, le Revenu de Transition Environnementale versé en contrepartie d’activités orientées vers l’écologie et le lien social… Mais globalement « Agir pour le Vivant » aurait dû s’appeler « Réfléchir au Vivant » : ses contenus très riches et passionnants ont certes permis d’élever le débat et d’avoir une vision holistique du vivant. Cependant, après la diffusion (émue) d’ANIMAL, le film de Cyril Dion montré en avant première à Arles, on sort convaincu que l’action est plus que jamais déterminante et urgente. Lui-même d’ailleurs nous donne une clef en nous encourageant, chacun dans notre métier, à agir, à élargir nos ambitions au-delà de gagner un salaire nécessaire à notre vie quotidienne, à donner du sens à ce que nous faisons.
3ème Escale : Le congrès mondial pour la nature
Et justement, en parlant d’actions… Ils ont été très nombreux à se retrouver, ces acteurs, au Congrès Mondial pour la Nature de l’UICN à Marseille. Ici, le Vivant qui a accompagné mon été est devenu biodiversité. Et ici, tous se battent pour lui conserver sa place. Des centaines d’associations et d’organisations se sont retrouvées pour débattre des différentes solutions mises en œuvre sur le terrain, en tirer des enseignements, convaincre les grandes entreprises présentes de jouer leur rôle. Les grandes institutions bailleurs de fonds sont présentes et les deals internationaux se font dans les couloirs, au détour d’un dîner, en buvant un verre autant qu’autour de la table des négociations. Toutes ces personnes disséminées de par le monde, sur des terrains souvent de combat, sont heureuses de se retrouver pour partager dans cette enceinte et on les comprend… et ça fait du bien.
Cela a aussi été l’occasion aux politiques de prendre des engagements forts en matière de protection des espaces. Espérons qu’ils se transforment en loi, décret, réforme : car tous ces experts sont unanimes. Au stade où nous en sommes, seuls des espaces extrêmement protégés pourront préserver ce qui reste de biodiversité.
Ces discussions de tous ordres ont couvert le bruit des cigales : espérons qu’elles fassent encore plus grand bruit prochainement, notamment auprès des entreprises de taille moyenne : on peut trouver dommage que personne ne s’intéresse dans l’enceinte de l’UICN au formidable levier d’actions que représente cette force économique.
De la même manière, les jeunes n’étaient pas très présents dans les débats en dehors de la formidable Magali Payen qui a présenté la nouvelle campagne de “On est prêt”. Pourtant, bien conscient de l’importance de l’éducation, l’UICN avait installé de nombreux stands de sensibilisation pour les enfants où l’on pouvait voir, (ré)apprendre un peu de Nature sous différentes formes. Une impressionnante œuvre, « Immersion », de Lise Marie Koelher, nous permettait de mieux comprendre le fonctionnement d’un éco-système le tout en réalité augmentée… Fascinant, très amusant, cela m’a questionnée. Faut-il augmenter la réalité pour comprendre la Nature, le Vivant, la biodiversité ? Pourquoi ne pas les emmener dans la vraie, celle que l’on peut toucher, sentir, expérimenter…
4ème Escale (Finalement la plus belle) : Les Açores
Dans le film de Cyril Dion, l’anthropologue Philippe Descola, répond à la question « Comment renouer avec le vivant ? » par une désarçonnante évidence : « en le fréquentant !».
Car finalement, toutes ces belles personnes rencontrées pendant mon voyage en biodiversité disent la même chose : on protège mieux ce que l’on connaît mieux. Lorsqu’on est dans la nature, en contact avec la biodiversité, on sent quelque chose de fort sur lequel nous ne sommes pas obligés de mettre des mots. C’est cette émotion qui nous fait comprendre à quel point ce Vivant est indispensable non pas à notre survie mais à notre vie. A partir de là, nous ne pouvons que nous engager à le respecter voire à le protéger.
Finalement, de retour sur mon sofa parisien d’où a commencé mon voyage, je me suis dit que j’en avais plus appris sur le vivant durant ma randonnée estivale dans les Açores qu’au terme de toutes ces conférences, débats et tables rondes… Ou plus précisément que gambader dans le Vivant des Açores m’a permis d’en faire autre chose de plus riche qu’un simple sujet de débat, d’étude, scientifique, chiffré et finalement désincarné. Les 2 sont finalement nécessaires : notamment pour passer à l’action.
SNCF • Programme d'engagement interne
LA DEMANDE
Voyages SNCF souhaitait communiquer en interne sur ses engagements environnementaux avec une campagne de communication.
NOTRE RÉPONSE
 Un programme d’engagement baptisé PARLER GREEN SANS ROUGIR.
Un programme d’engagement baptisé PARLER GREEN SANS ROUGIR.
1 • Une approche centrée sur les attentes & les besoins internes. C’est-à-dire avec une phase d’entretiens avec des agents pour jauger leur niveau de connaissances sur les sujets environnementaux… et choisir les messages et les supports adaptés à la réalité et à leurs usages.
Un double objectif :
• rendre fiers les agents des avancées et progrès SNCF sur les sujets environnement
• donner des clés de réponses aux clients pour porter ces enjeux sur les quais, à bord…
2• Un programme plutôt qu’une campagne. L’approche a été séquencée en 6 épisodes (CO2, ÉNERGIE, NUMÉRIQUE, DÉCHETS, CIRCULARITÉ, INNOVATIONS) afin d’avoir des prises de parole étalées, digestes et pédagogiques, diffusées sur les réseaux internes. Nous en avons simplifié le langage, évité ou bien expliqué les notions trop techniques ou complexes, adopté un ton enlevé et connivent. Des affiches, des vidéos portées par des influenceurs internes, un film pédagogique ont soutenu l’ensemble des prises de parole.
Digest Numérique
IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE : découvrez notre digest (il est gratuit) qui trie enfin le faux du vrai sur le sujet.
En collaboration avec le Studio Digital responsable Bruno Della Mattia, avec l’oeil avisé de Frederic Bordage de GreenIT.fr et de Florian Grill de l'agence CoSpirit MediaTrack.
Bref : du pédagogique, du solide, du synthétique, du pratique.
À télécharger ici : DigestNumérique_Hyssop
Podcasts OWN THE CHANGE pour le SIAL
“Le changement appartient à ceux qui s’en emparent”. Dans le cadre de podcasts que nous réalisons pour le SIAL (Salon international de l'alimentation), Dominique Royet confronte dans chaque épisode, à partir d’une question liée aux changements dans les domaines de l’alimentation, la vision d’un entrepreneur visionnaire, qui développe une initiative émergente, et la prospective proposée par une entreprise leader sur son marché.
Episode 1 : La Distribution, un lien modifié entre le producteur et le consommateur
Interviews de Charles Guirriec, Co-fondateur de Poiscaille, le panier de la mer en ligne et de Bertrand Swiderski, directeur développement durable du Groupe Carrefour.
Charles Guirriec, ingénieur de formation, a co-créé en 2015 Poiscaille qui assure aux consommateurs la livraison d’un poisson de qualité, en 48h, et la rémunération équitable de pêcheurs artisanaux qui n’utilisent que des techniques douces. Poiscaille a vu depuis le début de l’année et encore plus pendant cette crise du Covid son chiffre d’affaires progressé et parie sur une évolution forte de la vente directe du producteur au consommateur. De son côté, Carrefour a dû faire face à un transfert de ses ventes sur la proximité et à assumer un rôle sociétal fort. Ces 2 invités nous donnent leur avis sur l’évolution des différents modes de distribution alimentaire et Nicolas Trentesaux, DG SIAL Global Network, nous expliquera comment le SIAL prolongera ces discussions lors du Salon.
Episode 2 : L'accès à une nourriture de qualité, pour tous
Interviews de Thomas Jonas, Fondateur de Nature’s Fynd, entreprise américaine qui propose une nouvelle forme de protéine et de Carole Galissant, Directrice du pôle culinaire chez Sodexo France.
Thomas Jonas transforme une bactérie ultra résistante trouvée dans le parc de YellowStone en protéine et imagine proposer une alternative alimentaire pour nourrir les 10 milliards d’humains que nous devrions être en 2050. Carole Galissant travaille pour Sodexo à améliorer sans cesse la qualité de la nourriture servie, notamment dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants, quel que soit leur niveau de vie, d’avoir accès à une nourriture de qualité à un prix accessible. Nos deux invités nous donneront des perspectives très différentes et complémentaires sur ce sujet de l’accès à une nourriture de qualité. Adeline Vancauwelaert, Directrice de SIAL Paris, conclura notre podcast avec quelques informations sur la consultation menée par le salon sur le sujet.
SIAL Episode 3 : Alimentation et agriculture
Interviews de Nicolas Machard, fondateur de « Pour de Bon », une place de marché digitale qui propose les produits alimentaires frais et secs provenant de 400 petits producteurs et artisans français et Emmanuel Vasseneix, Président de la Laiterie de St Denis de l’Hôtel et à l’origine de la marque du consommateur « C’est qui le patron ».
Nicolas Machard et ses équipes sélectionnent rigoureusement des producteurs engagés à fournir des produits alimentaires de qualité et à utiliser des méthodes agricoles adaptées à la préservation de leur environnement.
Emmanuel Vasseneix, dont l’entreprise conditionne les différents liquides alimentaires (lait, jus de fruit, laits végétaux) est particulièrement sensibilisé à la valeur ajoutée pour les producteurs. Avec eux, en partenariat avec la distribution, il propose de garantir un prix décent pour maintenir des productions de qualité en France.
SIAL Episode 4 : Lien entre Alimentation & Santé
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es... L'adage paraît léger : pourtant, le lien entre alimentation et santé préoccupe 69% des Français. Dont le SIAL. Et dont nous.
Ainsi, pour creuser ce sujet, Dominique Royet a interviewé :
• Joël Doré, chercheur à l'INRAE et Directeur scientifique de MeTaGenoPolis. Internationalement réputé pour ses recherches, il a découvert le lien entre le microbiote intestinal et les maladies chroniques, neurodégénératives ou neuropsyciatriques.
• Christophe Barnouin, Président du Groupe Ecotone qui regroupe les marques Björg, Bonneterre, AlterEco...) et qui est pionnier de l'alimentation végétale et sans pesticides.
Dans ce podcast, tous deux mettent en avant le rôle que joue biodiversité dans notre alimentation. Comme tout simplement participer à nous maintenir en bonne santé. Rien que ça.
Pour débattre d’un sujet qui préoccupe 69% des français, interviews de Joël Doré, Chercheur à l’INRAE et Directeur Scientifique de MeTaGenoPolis. Internationalement réputé pour ses recherches, il a découvert les liens entre le microbiote intestinal et les maladies chroniques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques. Et Christophe Barnouin, Président du Groupe Ecotone. Le groupe Ecotone qui regroupe les marques Bjorg, Bonneterre, AlterEco… est pionnier de l’alimentation végétale et sans pesticides. Tous deux mettent en avant la biodiversité qui est clef pour que notre alimentation participe à nous maintenir en bonne santé.
Bonne écoute à vous !
3 questions à Frédéric Bordage, expert de la sobriété numérique
À l’occasion de la sortie prochaine de notre publication sur le numérique responsable, co-écrit avec le studio digital Bruno Della Mattia, Frédéric Bordage, THE expert de la sobriété numérique, a accepté de répondre à quelques questions. Nous étions ravis et impressionnés. Extraits.
Réservez gratuitement notre publication sur le Numérique Responsable en nous envoyant ici un « OUI : je le veux ».
Quel est, selon vous, le réel impact environnemental de la communication numérique ?
C’est tout d’abord fabriquer le numérique, qui représente 80% des impacts en France. Les 20% d’impacts restants sont dus à la production d’électricité due à son utilisation. Sur les usages liés à la communication digitale, les enjeux sont donc doubles. Tout d’abord faire en sorte que la campagne de communication tourne confortablement même sur des terminaux vieillissants pour éviter l’obsolescence. Puis de ne pas « saturer les tuyaux » avec des fichiers qui seraient très lourds. Il faut savoir que la communication digitale va avoir des impacts environnementaux indirects sur les éléments physiques. Par exemple, produire des vidéos publicitaires uniquement en 4K oblige les gens qui n’en ont pas à changer leur écran.
Que faut-il absolument éviter et quelles sont les bonnes pratiques ?
Tout ce qui va déclencher l’obsolescence, ou qui va engorger les tuyaux pour rien. On est aujourd’hui dans une communication très promotionnelle, qui pousse du contenu sans qu’on l’ait demandé. Une communication intelligente, qui serait un apport d’informations pour l’utilisateur moins intrusif, contribuera probablement à réduire les impacts environnementaux associés.
En termes de sobriété numérique, les bonnes pratiques vidéo sont, autant que possible : bannir l’autoplay, des résolutions par défaut acceptables et non maximales, car ce n’est pas forcément nécessaire tout le temps.
Votre avis sur le print VS numérique ?
Il y a une tendance de la société à opposer le papier aux octets, ce qui na aucun sens. Ce sont deux supports qui ont des impacts environnementaux différents. On a beaucoup d’épuisement de ressources abiotiques (ressources naturelles non renouvelables comme le pétrole ou les minerais) dans le numérique, et quasiment pas dans le papier. En revanche, fabriquer de la pâte à papier cause beaucoup plus d’eutrophisation*. Les études comparatives qui sortent aujourd’hui sont toutes à charge, alors qu’on devrait être dans une articulation intelligente entre ces 2 supports. Et cela pour en tirer le meilleur parti : un minimum d’impact environnemental avec une meilleure efficacité en termes de communication. Entre un livre papier et Kindle, par exemple, celui utilisé le plus souvent et longtemps aura le moins d’impact. Ici, c’est probablement le livre emprunté à la bibliothèque qui sera le plus efficace. Dans le monde de la communication digitale, il y a probablement un modèle à trouver en s’inspirant de cette réflexion.
*eutrophisation : Apport excessif d’éléments nutritifs (nitrates et phosphates) dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l’écosystème. Les effluents des fabriques de pâtes et papiers peuvent être d’importantes sources externes de matières organiques dissoutes et particulaires dans les systèmes aquatiques, d’où une eutrophisation accrue des milieux récepteurs.
L'expert
Spécialiste français du numérique responsable, Frédéric Bordage a créé en 2004 la communauté GreenIT.fr. Elle abrite une centaine d’organisations et d’entreprises (Collectif conception numérique responsable, Club Green IT) qui s’intéressent et prennent part au numérique responsable.
Réservez gratuitement votre publication sur le Numérique Responsable
L’insoutenable légèreté des initiatives green
INfluencia • Le 06.03.2021
Faire ses courses dans un supermarché devient le parcours du combattant responsable par excellence, tant les messages sont partout, différents, parfois dissonants. On y trouve, en vrac mais toujours emballé : de l’éco responsable, de la beauté plus durable, de l’élevage responsable, du labellisé à qui mieux mieux, de la filière durable, de la compensation carbone, de l’engagement dans la transition écologique, du made in France, de l’emballage réduit et/ou en matière recyclé voire recyclable, du jetable éco-responsable (notons l’oxymore)…
Bref. On reprend notre respiration en même temps que nos esprits pour déplorer cette surenchère qui en met partout, et l’envie de ranger la chambre nous démange pour gagner en lisibilité.
On veut des preuves.
Bien sûr, toutes ces entreprises se déclarent engagées…. mais pour beaucoup, engagées seulement à promouvoir leurs produits, en parlant responsabilité, environnement, naturalité et autres termes qui en soit ne signifient pas grand-chose. Que serait un produit ou une marque non responsable ? Estampiller des mots green sur un packaging même allégé ne suffit pas pour la planète, et ne suffira plus pour le consommateur. Pour juger de ce qui est intéressant ou non pour la Planète (l’environnement et les hommes), il faudrait voir en quoi ces formules green qui se veulent magiques, souvent concoctées sur un coin de table marketing, reposent sur des preuves. Et si oui, en quoi les actions réalisées sont pertinentes par rapport aux enjeux de leur secteur. C’est une des conditions pour optimiser leur utilité pour la planète mais également leur crédibilité vis à vis du consommateur.
On a besoin de confiance.
On ne peut que se réjouir de l’engouement des marques à faire évoluer leurs produits. Mais nous devons nous assurer que ces évolutions sont légitimes, et réellement positives. Les mini-scandales, articles démontant telle ou telle initiative ou marque, nourrissent la défiance des consommateurs. Communiquer sur l’engagement d’une marque permet de lui donner une préférence : il est vital de le reposer sur des preuves et de la transparence. C’est à cette seule condition que l’on pourra créer un mouvement de masse plus vertueux chez les consommateurs. Quelques labels, comme le bio, ont réussi à émerger malgré des égratignures… Mais sinon c’est le plus grand flou.
Cohérence. Pertinence. Transparence.
Il est absolument nécessaire de se poser les bonnes questions, bien en amont. À quoi bon utiliser toujours plus de sacs poubelles jetables, même en plastique recyclé, si on ne réfléchit pas à optimiser l’expérience de tri du consommateur ? En quoi un produit « made in France » (la loi dit « au minimum assemblé en France ») est-il plus responsable qu’un produit sourcé dans des pays en développement dans de bonnes conditions, qui permettent aux populations locales d’avoir des revenus et de faire perdurer leurs traditions ? Que signifie « naturel » ? Tant de filières peuvent être considérées comme naturelles alors même que leur culture utilise des pesticides et des engrais. Réduire ses packaging est certes une bonne idée, déjà d’un point de vue économique… mais ne suffit pas à affirmer qu’une marque est responsable : n’y a-t-il pas autre chose à creuser dans son produit avant de se gausser d’un emballage allégé ? A-t-on pensé en même temps, à la composition du produit, à l’économie de son usage, à son gaspillage ? Il est important de considérer le produit dans son ensemble. Ne pas s’attaquer aux enjeux majeurs sera tôt ou tard une lacune qui pénalisera la marque…
Que faire ?
Aujourd’hui nous savons tous qu’il faut agir. Les marques que nous accompagnons sont très souvent animées d’une vraie volonté d’évoluer. Mais, pour beaucoup, la tâche est ardue : par manque de culture, d’expertises, de vision globale… C’est pourquoi il est important de réfléchir avec eux sur l’ensemble du cycle de vie du produit : même peu poussée, cette analyse identifiera les impacts principaux, les enjeux sociaux et sociétaux de la consommation, les problèmes de fin de vie et les solutions pour y répondre.
C’est une fois ce travail fait (et pas avant) que la communication pourra prendre le relais : expliquer, vulgariser les points précis où l’on aura agi, et raconter de façon globale la démarche, quitte à expliquer ce qui n’a pas pu être fait, ce qui est en cours. La transparence, c’est un des principaux leviers de confiance. C’est ainsi que nous pourrons fidéliser les consommateurs aux marques « engagées ». L’engagement est une valeur universelle, belle et forte. Il ne s’agit pas, aujourd’hui moins que jamais, de la galvauder pour gagner momentanément quelques parts de marché.
SNCF : campagne interne PARLER GREEN SANS ROUGIR
Article paru sur le site Sircome (04.03.2021)
Je vous présente aujourd’hui un programme de sensibilisation interne, intitulé « Parler green sans rougir ». Il vise à renforcer la fierté des agents de SNCF Voyageurs relativement aux engagements RSE de leur entreprise et atouts environnementaux du train. Cette action a été conçue par l’agence Hyssop [dont j’aime beaucoup le slogan qui figure sur leur homepage : « L’avenir, on y croit dur comme faire« ].
1 étude des comportements
L’agence a réalisé une étude des attentes et comportements des collaboratrices et collaborateurs, en interrogeant notamment une dizaine de salarié·e·s dans plusieurs métiers et plusieurs territoires (service client, guichet, contrôleur TGV, conducteur, cadre etc.). L’objectif était d’identifier les supports de communication les plus appréciés et de transmettre les informations qui les intéressent de la manière la plus efficace possible.
5 épisodes
Le programme se déroule en 5 épisodes, qui abordent et expliquent de façon simple, ludique et engageante les différentes actions menées par la SNCF Voyages : le carbone, l’énergie, les déchets, le bar TGV Inouï, l’économie circulaire. Vous trouverez ci-dessous les premiers visuels.
Rendre fiers
Ce programme a été nommé « Parler green sans rougir » et l’explication suivante figurait l’un des supports de communication : « Parler green sans rougir, c’est le faire avec fierté, mais surtout assurance. Parce qu’on ne peut pas tout savoir, qu’on en apprend tous les jours, retrouvez progressivement dans cet article toutes les clés pour comprendre ce qu’est notre atout bas carbone et connaître l’ensemble de nos actions en faveur de l’environnement, pour les partager avec ceux qui voudraient en savoir plus, comme nos clients, vos amis et même vos enfants… car ce sont eux les plus concernés par l’avenir que nous leur laissons ».
Le sentiment de fierté est également entretenu : « Fiers de notre atout bas carbone. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, chacun à notre mesure, à bord, en gare, aux guichets, dans les bureaux : car nous le faisons tous au service d’une entreprise qui s’engage à préserver l’environnement, et nous le disons dans notre dernière campagne de communication externe sortie début décembre ».
Cette campagne est intéressante à plusieurs titres : la démarche de prise en compte des perceptions et des attentes des publics en amont, les messages pédagogiques et le ton légèrement décalé, l’inclusion de tous les métiers dans la réussite de la démarche, l’installation sur un temps long…
Mais…
Un point de vigilance toutefois : la représentation de la face avant d’une locomotive sous forme végétale pourrait être considérée comme un abus de l’argument écologique. Je rappelle le point 8.4 de la Recommandation Développement durable : « l’assimilation directe d’un produit présentant un impact négatif pour l’environnement à un élément naturel (animal, végétal…) est à exclure. » Je remercie Dominique Royet et Thomas Maury de l’agence Hyssop de m’avoir transmis ces éléments. N’hésitez pas à nous tenir au courant des prochaines étapes de cette campagne et des réactions associées 😉
Le diable s'habille en Vinted
INfluencia • Le 03.02.2021
J’ouvre les yeux, et je m’aperçois devant mon miroir flambant vieux (80’s, chiné à la Braderie de Lille), qu’ils sont devenus 2 billes de naphtaline qui me chuchotent à l’oreille que c’était mieux avant. Avant me dit à son tour que ce ne sera pas mieux demain, et Demain, lui, se tait (il en a assez qu’on décide à sa place de son avenir).
Silence. Un ange passe.
Il est habillé en Gucci, sneaker Nike Dunk et sac Hobo Prada d’occase (les must-have de la seconde main 2020 selon Vestiaire Collective) : ça m’inspire. Je plonge dans mon vestiaire à moi où ça se bouscule pas mal. Les pieds-de-poules se prennent le bec, le tartan me fait de l’œil, le Prince de Galle me fait du pied-de-poule… Comme chaque matin ça tourne en rond. Ce sera T-shirt blanc H&M et Jean Uniqlo. Comme d’hab.
TROP.
Parce qu’en fait je ne tourne (en rond) qu’avec 15 tenues, alors que mon dressing m’en propose inlassablement 40 chaque matin. L’ange repasse en me criant en effet que « 70% de ta garde-robe n’est pas portée » (il l’a lu sur le Huffington Post) et disparait en enfonçant une porte ouverte : on accumule tant et tant de fringues qu’on ne sait plus quoi en faire.
VINTED.
Cette plate-forme, inventée par les lituaniens Milda Mitkute et Justas Janauskas en 2008, part justement de ce constat : ce volume impensable de fringues qu’ils ne portaient plus (des T-Shirt qu’ils ne se souvenaient même pas avoir achetés). Ils ont décidé de créer un système d’échange entre copains / voisins. Malin. Le monde étant ce qu’il est (petit), nous sommes aujourd’hui 21 millions de voisins, dont 8 millions de Français, à utiliser Vinted dans 11 pays européens, plus les États-Unis. Pour 1,3 millards d’euros de CA prévu en 2019. Mirobolant.
MIAM.
Un succès si appétissant que tout le monde y va de sa plate-forme seconde main : Camaïeux, Cyrillus, Darty, Weston, Kiabi, Cdiscount, La Redoute (avec La Reboucle), OKAIDI & son troc, Petit Bateau, Décathlon… On ne compte plus les initiatives d’occase. Une manne juteuse qui redore l’image des marques en la verdissant. On estime qu’en 2028, le marché de la seconde main dépassera, en volume celui de la fast fashion (source). Et sur les 40% de Français qui auraient déjà acheté des vêtements d’occasion en 2019, la moitié a eu recours à Vinted. (source france info de Institut Français de la mode x FEVAD). Est-ce une bonne nouvelle ?
VERTUEUX.
La seconde main, ça fait partie du passé ET de l’avenir : notre présent est tout simplement en train de s’en souvenir. On ne produit pas de nouvelle matière, on réduit les émissions CO2 et pollutions en tout genre (air, eau… souvenons-nous que l’industrie textile est la 2e plus polluante), on allège notre poids sur l’utilisation des ressources naturelles (fabriquer un tee-shirt nécessite l’équivalent de 70 douches et un jean, 285), on transforme un déchet en ressource tout en générant de la richesse économique. Bref : c’est super.
MAIS VICIEUX.
Ça fait tellement de bien qu’on a tendance à redoubler d’efforts. Comme « en plus, ça fait du bien à la planète », on reproduit voire intensifie notre boulimie d’achat #déculpabilisation. Ces baskets Common Project à seulement 60€ : « j’en ai 4 paires, mais pas tout à fait les mêmes ». J’achète.
Est-ce la circularité ou l’achat à pas cher qui motive les utilisateurs Vinted ? Son caractère vertueux, qui peut devenir une bonne excuse à acheter, n’aurait-il pas desservi son but : une consommation plus raisonnée ? Est-ce que son modèle n’aurait pas été dévoyé par nos mauvaises habitudes : « de toute manière, je le revendrai sur Vinted » ? L’arrivée de Thomas Platenga aux commandes de la fripe en ligne, en 2016, avec ses méthodes d’incitation reprises des sites e-commerces, aurait-elle rendu Vinted un épouvantail à € et à bonne conscience ?
En outre, Vinted ne géolocalise pas l’achat : les articles arrivent donc de parfois très loin, générant beaucoup de transports.
Enfin, cette économie de la seconde main fait main basse sur des articles autrefois donnés aux associations comme Emmaüs.
PAREIL.
Avec Vinted, ou autre, on fait finalement pareil. Nos dressing débordent tout autant d’occase que de fast fashion (qui sont parfois les deux). Tant que l’industrie continuera à sur-produire, à nous biaiser pour que l’on achète toujours plus (comme ASOS par exemple qui permet de ne payer qu’au moment de la réception de la marchandise), tant que nous, consommateurs, ne modifierons pas notre comportement naturel d’accumuler (acheter, comme les études le disent : ça rassure, ça procure du plaisir, ça rend heureux, et ça apaise nos tensions) il est normal que le marché de la seconde main croisse autant. Quand on achète trop, on revend beaucoup.
Le fait que la seconde main surpasse la première main en 2028 est une bonne nouvelle, mais à condition que le neuf diminue ses volumes… ce qui n’est pas tout à fait prévu.
LE DIABLE.
Des voix critiquant le bien-fondé de Vinted ont fleuri sur internet. C’est vrai : certaines pratiques sont largement discutables, de la part de la marque comme des utilisateurs : ces « conso-marchandes » comme les appelle Élodie Juge, ingénieure recherche pour la chaire Trend(s) qui analyse depuis 2013 le comportement des pratiquantes les plus assidues de Vinted qui l’utilisent comme une source de revenu, et non comme une ressource plus vertueuse.
Mais nous, chez Hyssop, serions plus nuancés. Le diable que nous évoquons n’est pas Vinted : ce sont nos habitudes, nos pulsions, notre culture de la possession. Vinted n’est pas innocent, mais nous ne sommes pas non plus à sa merci. On peut toujours décider.
LE BON SENS.
Renouons avec un peu plus de bon sens. Nous, consommateurs, comme Vinted, qui pourrait revoir un tantinet son business model pour retrouver la raison pour laquelle il est né : faire du vide dans son dressing, tout en préservant la planète. Refuser de croître : est-ce si insensé ? Tout comme Craigslist, le LeBonCoin américain qui a refusé de se moderniser, de se pervertir. Tout dépend quelle logique on adopte. Je vais personnellement terminer cet article en allant donner à Emmaüs Défi ces baskets Common Project achetées à seulement 60€.
Design d'Utilité Publique
Influencia • Le 12 mai 2020
Il y a quelques semaines, au petit-déjeuner, ma fille m’a demandé de lui “tartiner du beurre sur son pandémie”. Humm… Ce COVID n’obsède décidément pas que les grands. Scientifiques, économistes, gros groupes, petites start-up, Pierre Paul & Jacques : tous sont d’accord. Il est urgent de réorienter et repenser nos modèles, notre société, nos façons de vivre et de produire ensemble. Tous rejoignent (enfin) ce que le Club de Rome préconisait il y a 50 ans : une transformation radicale de notre société face aux limites de la croissance (1972, Rapport Meadows). Le Développement Durable entre en scène. Quelques entreprises s’en sont emparé et voient d’ailleurs aujourd’hui les fruits de leur engagement. Mais beaucoup n’y sont allées qu’à la marge. Aujourd’hui, nombreuses sont celles convaincues de la nécessité de réfléchir à leur RSE, poussées par leurs parties prenantes (consommateurs, fournisseurs, salariés…) mais aussi par une urgence devenue aussi palpable que virale.
Ce COVID est un révélateur.
Le bon dans tout ça, c’est qu’il a stoppé net notre course à on ne sait plus trop quoi. Le monde entier s’est arrêté et a écouté Demain tousser, nous dire comment il allait (mal), et que ce COVID n’est pas la vraie maladie mais simplement un petit symptôme, épiphénomène du chaos qui nous attend. Ce chaos qu’on percevait comme un futur pas si grave, pas si proche, est en train de débarquer, comme le plus angoissant des épisodes de Black Mirror.
Le temps est à l’action : vive la “RSE augmentée”
Agir, cela passe bien sûr (car oui : on en est sûrs) par la RSE, le green, le responsable, l’innovation durable… Peu importe son nom, c’est à base de bon sens. Face à l’urgence (pour rappel, on n’a que 10 ans pour agir, selon l’AFD), des connexions, des mix d’intelligences hétérogènes, des collaborations doivent se mettre en place. Dire “On est plus forts à plusieurs” serait enfoncer une porte ouverte, mais tant pis : on l’enfonce parce qu’elle est ouverte sur de belles solutions pour l’avenir.
Parmi les forces à actionner, le Design porte son lot de belles promesses.
Le designer, ce créatif au service de la fonction, est un écoutant hors pair, un ciment du travail collaboratif. On le retrouve partout : designer industriel, UX, mobilier, graphique, textile, de services, d’espaces publics… Partout, sauf en RSE. Le plugger à nos problématiques durables, entouré d’expertises pertinentes, est une clef de mise en action, capable de décadrer les problèmes, de nouer les intelligences en intelligence collective, de passer à l’action rapidement sous forme test&learn avec un focus sur l’analyse du besoin réel user centric…. Cette nouvelle alchimie est ce qu’on pourrait appeler une “RSE augmentée” : on décadre et on pense à plusieurs, et surtout on agit vite (place au Design Doing !), on accélère, avec et pour les entreprises.
Les entreprise : ce sont elles les locomotives.
Aujourd’hui affaiblies, un brin désemparées, elles sont obligées de repenser leur modèle. C’est justement le moment de remettre leur pendule à l’heure (qui est grave) : réfléchir leur raison d’être, en fixer un cap et l’incarner grâce à des actions concrètes, faire évoluer leurs produits, leurs services, leur communication, leurs engagements, pour aller dans le sens de leur responsabilité sociale et environnementale, et celui de l’Histoire en général.
“J’ai l’audace de penser que, aux côtés des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs, des sociologues ou des entrepreneurs, les designers sont déterminants pour penser et rendre intelligibles, utiles et agréables, ces alternatives qu’il ne faut plus, à présent, tarder de proposer” confiait le designer Ramy Fischler au journal le Monde.
La crise sanitaire a été un coup de fouet
Elle a généré de belles actions initiées par des designers qui ont su réagir vite, bien, et à propos. Cette poignée toulousaine que l’on ouvre avec le coude; ces réflexions du designer visionnaire Patrick Jouin sur Concilier distance et réouverture des restaurants menées avec Alain Ducasse; ces CURA Pods, containers transformés en capsules de soins intensifs par un groupe de travail international (architectes, ingénieurs, médecins, militaires); cet appareil d’aide respiratoire (OxyGEN) fabriqué en Espagne avec un moteur d’essuie glace et produit vitesse grand V avec Seat; le masque EasyBreath de Decathlon, pimpé pour s’adapter au Covid par un médecin et une entreprise spécialisée en impression numérique… sont autant de vibrantes (et vivantes) preuves de la créativité associée à l’intelligence collective. Trois journalistes ont d’ailleurs répertorié de telles initiatives sous le #DesignResistenza.
Le brief était le COVID. Imaginez maintenant tous les autres briefs.
Ceux que l’urgence climatique & sociale nous souffle (dans les bronches) et comment la RSE augmentée (designers et expertises ciblées) pourrait les nourrir, les twister, les emmener plus loin. Accompagner la mutation des modes de travail (plasticité entre vie professionnelle et privée, besoin de reconnaissance et de sens des salariés, écarts de génération millenials VS les autres, fidélisation des talents…). Transformer les centres commerciaux en centres de lien, plus ouverts et fluides (surtout en ces temps de pandémie). Renouer avec la nature, quand plus de 2/3 de l’humanité vivra en ville en 2050; et comment la repenser comme un vrai lieu de vivre ensemble. Moins peser sur nos ressources non renouvelables; et comment mieux revaloriser les autres ? Améliorer le circuit (agro)alimentaire, la proximité consommateur/producteur, le mieux manger ? C’est quoi d’ailleurs mieux manger ? Repenser des lieux où les seniors passent leurs dernières années mieux entourés…
Designers : les briefs sont infinis, vos solutions le sont tout autant !
Passons de la promesse à l’action. En mettant nos lunettes RSE Augmentée, nous aimons réinterpréter ces promesses de grandes marques sous l’œil de la satisfaction RSE et non plus uniquement client. Faire du ciel le plus bel endroit de la terre, ce fameux 2e effet KissCool, Parce que nous le valons bien, energisons la vie tous les jours, Just do it… Ben oui, justement : let’s just do it. Designers, c’est le moment ! L’appel est lancé.